« Pour nous, Cubains, l’Afrique, c’est notre cœur, notre sang »

Né en 1937 à Sagua la Grande au sein d’une famille modeste, Víctor Dreke a vécu dans sa chair les réalités de la Cuba prérévolutionnaire marquée par la misère, le racisme et les discriminations en tout genre. Il fréquente les milieux ouvriers, notamment le secteur sucrier très présent dans sa région natale et se reconnaît dans leurs revendications de justice sociale. Il devient par la même occasion le représentant étudiant de son établissement scolaire et exprime les inquiétudes de sa génération.
Le 10 mars 1952, il fête tout juste ses quinze ans lorsque le général Fulgencio Batista orchestre un coup d’État qui brise l’ordre constitutionnel pour installer une dictature militaire qui durerait six longues années. Il découvre la figure de Fidel Castro suite à l’attaque de la caserne Moncada le 26 juillet 1953 à Santiago de Cuba et s’identifie immédiatement à sa cause, défendue dans son plaidoyer/réquisitoire connu sous le nom de « L’Histoire m’acquittera ».
Avec le déclenchement de la lutte armée à partir du 2 décembre 1956 dans la Sierra Maestra suite au débarquement des révolutionnaires dans l’île, Víctor Dreke prend également le maquis dans la région centrale du pays. Il y fait la rencontre de Che Guevara et participe aux combats finaux à Santa Clara en décembre 1958.
À l’avènement de la Révolution cubaine le 1erjanvier 1959, Víctor Dreke est nommé procureur des Tribunaux révolutionnaires chargés de juger les crimes de sang commis par l’ancien régime. Il participe également à la lutte contre les groupuscules armés contre-révolutionnaires présents dans la Sierra del Escambray et fait face à l’invasion de la Baie des Cochons organisée par les États-Unis.
En 1965, il est sollicité par la haute direction du gouvernement pour organiser le groupe de combattants volontaires pour porter secours à la guérilla au Congo en compagnie de Che Guevara. Il dirige également diverses missions internationalistes en Guinée Bissau et au Cap-Vert à la demande d’Amilcar Cabral, qui mène alors une guerre de libération nationale contre le colonialisme portugais. Aujourd’hui Président de l’Association d’amitié Cuba-Afrique, Víctor Dreke revient sur son histoire et évoque les liens qui unissent l’île de la Caraïbe au berceau de l’humanité.
Salim Lamrani (Université de La Réunion) : Quels souvenirs avez-vous de votre enfance et de votre jeunesse ?
Víctor Dreke : Je suis né le 10 mars 1937 dans une ville nommée Sagua la Grande dans l’ancienne province de Las Villas, appelée aujourd’hui Villa Clara. C’était une zone prospère à l’époque. Je suis le cadet d’une famille recomposée.
Ma famille portait le nom de Castillo Dreke, qui était celui de mon père. Ma mère Catalina Mora venait d’un village appelé Sierra Morena, près de Sagua la Grande. J’aurais pu porter le nom de Castillo, comme cela a été le cas de l’un de mes frères, mais mon père a choisi de me donner le nom de Dreke.
Je dois dire que j’étais un enfant chanceux au milieu de la misère qui frappait le pays à cette époque. Ma mère Catalina qui m’a mis au monde et ma mère adoptive Felicia qui m’a élevé ont pris grand soin de moi. Ma famille était pauvre et nous vivions dans une maisonnette au toit de guano de la rue Agramonte n°30 de Sagua la Grande. Je n’étais pas un mauvais garçon et je dois dire que j’ai bien été éduqué. Je me rappelle également que lorsque je rendais visite à mes amis à l’heure du déjeuner et que l’on me demandait si j’avais mangé, on m’avait appris à répondre toujours la même chose, à savoir que j’avais déjà mangé et que je n’avais pas faim, même si ce n’était pas vrai. C’était notre éducation.
Comme tous les enfants de mon âge, j’ai fait quelques bêtises mais je n’étais pas méchant. Mon nom complet est Victor Emilio et mes camarades d’enfance m’appelaient « Emilito ». Si je me compare avec les enfants d’aujourd’hui, j’étais un gamin sans grande éducation. J’ai fréquenté une école privée qui était payante, tenue par des religieuses, et je me rappelle que nous devions prier le vendredi. Cependant, je n’ai pas été baptisé avant l’âge adulte pour des raisons familiales. Je n’étais pas un mauvais élève, sans pour autant être brillant.
SL : Avez-vous un souvenir du coup d’État de Fulgencio Batista du 10 mars 1952 ?
VD : Je m’en souviens parfaitement car c’était le jour de mon anniversaire, de mes 15 ans. Avec un groupe de jeunes, nous sommes sortis manifester dans la rue contre le coup de force. Nous avons été arrêtés par la police, qui nous a conduit au commissariat avant de nous relâcher. Je puis dire que mon engagement d’aspirant révolutionnaire a débuté à cette date précise.
Mon père s’évertuait à m’expliquer la situation dans laquelle se trouvait le pays. Il était sympathisant du Parti Authentique de Ramón Grau San Martín et Carlos Prío Socarrás, sans être très politisé. Il avait été auparavant lié au Parti Libéral. Il était vendeur de poissons et pensait que tous les hommes politiques étaient pareils, qu’ils étaient prolixes lorsqu’il s’agissait de faire des promesses électorales, mais beaucoup moins inspirés dès lors qu’il fallait adopter des mesures pour le bien commun. Mon grand frère Mario, quant à lui, était militant du Parti Orthodoxe d’Eduardo Chibás.
Pour ma part, je n’appartenais à aucun parti. Je n’étais pas marxiste. D’ailleurs, à l’époque, je n’avais entendu que des choses négatives au sujet du communisme. Je participais aux grèves ouvrières du secteur sucrier. Il y avait beaucoup d’usines sucrières dans la province. J’étais également représentant étudiant à l’École supérieure de garçons José Marti à Sagua la Grande. Je me suis donc politisé de cette façon, en militant avec les travailleurs et les étudiants. J’étais résolument opposé à la dictature qui assassinait les opposants et plongeait le peuple dans une misère sans nom. J’ai le souvenir que la police nous disait que les Noirs ne pouvaient pas être des révolutionnaires. J’en tremblais d’indignation.
SL : Comment se manifestait le racisme à Cuba sous le régime militaire de Batista ?
VR : Nous étions victimes de discrimination en raison de notre couleur de peau. Nous avions moins de droits. Il en allait de même pour les femmes vis-à-vis des hommes : elles subissaient l’oppression d’une société patriarcale.
Je suis devenu révolutionnaire pour trois raisons fondamentales. Tout d’abord, parce que j’étais pauvre et que je devais me battre pour subvenir à mes besoins vitaux. Ensuite, parce que j’étais jeune car la jeunesse est toujours rebelle. Enfin, parce que j’étais noir et que je souffrais du racisme.
SL : Quel souvenir avez-vous de l’attaque de la caserne Moncada par Fidel Castro et ses compagnons le 26 juillet 1953 ?
VD : Mon engagement révolutionnaire est antérieur à l’apparition du Mouvement 26 Juillet de Fidel Castro. Nous étions très attachés à la figure et aux idéaux d’Antonio Guiteras qui avait été l’âme de la Révolution de 1933 et qui avait été assassiné par Batista. Nous avions un mouvement qui s’appelait Acción Guiteraset nous organisions une cérémonie en son honneur chaque 8 mai, jour de sa disparition. Nous étions à chaque fois réprimés par la police que nous affrontions à jets de pierre. A cette époque, ma ferveur s’appelait Guiteras. Nous étions également adeptes de Rafael García Bárcena, un professeur de philosophie opposé à Batista qui avait fondé le Movimiento Nacional Revolucionario.
Je ne connaissais pas Fidel. J’ai découvert son existence lors de l’attaque contre la caserne Moncada. L’action révolutionnaire de Fidel a eu lieu l’année du centenaire de la naissance de José Marti, notre héros national. Je me souviens de son plaidoyer L’Histoire m’acquittera dans lequel il avait dénoncé la situation du pays, la discrimination raciale, l’analphabétisme, la misère et les injustices de toutes sortes. J’ai été profondément marqué par son entreprise où il avait risqué sa propre vie et par son discours qui était à la fois un plaidoyer en faveur de son action révolutionnaire et un réquisitoire contre la dictature de Batista. Il s’était engagé à réparer toutes les injustices une fois la Révolution victorieuse. Je me suis immédiatement identifié à sa ligne. Notre génération avait enfin trouvé son leader.
SL : A quel moment avez-vous décidé de vous unir à la lutte armée suite au débarquement de Fidel Castro dans l’île en décembre 1956 ?
VD : Il y avait au sein du mouvement ouvrier une tendance favorable à la lutte armée dirigée par Victor Bordón Machado, qui deviendrait par la suite Commandant. J’ai intégré ce groupe qui répondait davantage à ma sensibilité et j’ai été nommé chef « d’Action et de sabotage » du Mouvement 26 Juillet dans un premier temps, en 1957, dans la zone de Santa Clara, dans l’Escambray. Nous avions peu d’armes et il fallait se les procurer auprès de l’ennemi.
Par la suite, en tant qu’étudiant, je suis passé au Directorio Revolucionarioet j’ai opéré dans la capitale. Il y a eu deux aspects dans l’engagement du Directoire : la lutte clandestine dans les villes et la lutte armée dans le maquis.
Il faut rappeler que la plupart des révolutionnaires, à commencer par Fidel Castro, étaient issus de l’université, qui était l’épicentre du processus émancipateur. Il y a eu par la suite un rapprochement entre le Mouvement 26 Juillet et le Directoire. A la fin de la guerre, je n’étais plus membre du Directoire mais membre de la Révolution.
SL : Quand avez-vous fait la connaissance de Che Guevara ?
VD : J’ai connu le Che en octobre 1958 lorsqu’il est arrivé dans l’Escambray. Il était venu nous rendre visite au Quartier Général du Directoire pour voir Faure Chomón, notre commandant. Il est arrivé avec sa colonne légendaire de guérilleros, qui était respectée de tous car elle avait traversé toute l’île à pied au prix d’un effort titanesque, suivant les directives de Fidel.
Je me souviens qu’en prévision de l’arrivée du Che, nous avons attaqué deux lieux : Fomento et Placeta. C’était un dimanche sous une pluie torrentielle. Notre but était de mobiliser l’attention de l’armée afin que la colonne puisse arriver dans l’Escambray sans encombre. J’ai d’ailleurs été blessé à Placetas. Notre concours était modeste, symbolique, mais cela fut suffisant pour permettre au Che de remplir sa mission.
Le Che m’avait fait grande impression. Il est arrivé au campement où je me trouvais, blessé, et je me souviens qu’il m’a demandé s’il pouvait utiliser la machine à écrire. Cela nous avait marqué car nous avions pour ordre de nous mettre au service du Che. Il a fait preuve d’une grande courtoisie. A Santa Clara, les gens ne savaient pas réellement qui était cet Argentin venu combattre pour notre cause. On revivait l’histoire de Máximo Gomez, le Dominicain qui a combattu à nos côtés durant la Seconde guerre d’indépendance. C’était tout un symbole.
SL : Au triomphe de la Révolution en 1959, vous avez été nommé procureur des tribunaux révolutionnaires. Quel était l’objectif de ces institutions qui rendaient une justice expéditive ?
VD : Le but était de juger les personnes qui avaient commis des crimes. Durant la dictature de Batista, 20 000 Cubains ont été assassinés, souvent dans des conditions atroces, par les sbires de la tyrannie. Notre grande préoccupation était que les familles et les amis de ces personnes lâchement assassinées, les parents des femmes qui avaient été violées, rendent justice par eux-mêmes. Nous ne voulions pas que le peuple lynchent ces individus dans les rues. Il n’y avait que deux possibilités : soit créer les tribunaux révolutionnaires et appliquer la loi, soit laisser le peuple se charger des criminels. Nous avons l’expérience de ce qui était survenu ailleurs, notamment en Europe à la fin de la Seconde guerre mondiale, et nous ne voulions pas d’exécutions extrajudiciaires.
L’une des caractéristiques de notre Révolution est qu’il n’y a pas eu de massacres lors de la chute du régime militaire. Il n’y a pas eu de vengeance. Fidel avait été très clair à ce sujet et avait demandé au peuple de faire confiance aux tribunaux pour rendre justice.
En ce qui me concerne, après avoir participé aux combats qui ont conduit à la prise de Santa Clara, en tant que chef de l’escadron 31, je me suis rendu à La Havane pour voir ma famille. La Révolution a ensuite sollicité mon concours en tant que procureur des tribunaux révolutionnaires qui venaient d’être créés. Je suis retourné à Santa Clara où, en plus de mon rôle de procureur, j’étais membre du Conseil supérieur chargé d’analyser toutes les décisions prises par les tribunaux révolutionnaires, afin d’éviter toute erreur et ne pas appliquer de peines inutiles. Nous étions particulièrement attentifs au respect de la dignité des accusés. Ils avaient droit à un avocat. Ils n’ont jamais été maltraités et nous autorisions les visites familiales. Ce n’était pas facile de voir une petite fille rendre visite à son père condamné à la peine capitale. Mais il fallait appliquer la loi. Nous nous souvenions des crimes commis par ces mêmes personnes.
SL : Vous avez participé à la lutte contre les groupuscules contre-révolutionnaires qui se sont formés, notamment dans les montagnes de l’Escambray, suite à l’avènement de la Révolution. Comment s’est déroulée la lutte contre ces individus ?
VD : Dès 1959, il y a eu des groupes armés et soutenus par les États-Unis qui conspiraient contre la Révolution. Il faut se souvenir que l’administration Eisenhower a soutenu Batista jusqu’aux ultimes instants, en lui faisant parvenir des armes. Dans l’Escambray, il y avait des groupuscules armés qui s’en prenaient aux paysans qui étaient majoritairement favorables à la Révolution, qui s’en prenaient aux enseignants qui participaient à la campagne d’alphabétisation. Ces hommes préparaient le terrain pour la future invasion. Leur objectif était de créer une tête de pont. Le plan stratégique était d’organiser un soulèvement interne lors d’un futur débarquement pour soutenir les envahisseurs. On ne peut pas séparer Playa Giron, ou la Baie des Cochons, de la lutte contre-révolutionnaire de l’Escambray.
Fidel Castro, notre Commandant en chef, a donc pris la décision de contre-attaquer et liquider ces groupuscules soutenus par le gouvernement yankee qui se trouvaient principalement dans l’Escambray, mais également dans la province orientale et à Pinar del Río. Nous avons effectué une grande battue et nous avons neutralisé la plupart de ces groupuscules avant l’invasion d’avril 1961. Notre appareil de la Sécurité de l’État avait infiltré ces groupes de bandits. La lutte a duré jusqu’en 1965.
SL : En avril 1961 a eu lieu l’invasion de la Baie des Cochons orchestrée par les États-Unis et la CIA. Vous avez personnellement participé à ces combats. Racontez-nous ces évènements ?
VD : Avant l’invasion d’avril 1961, il y a eu les sabotages, les actes de terrorisme comme l’explosion du bateau La Coubreen mars 1960 qui avait coûté la vie à près d’une centaine de personnes, les bombardements aériens en provenance de Floride etc.
Le jour de l’invasion, je me trouvais en voiture en direction de Santiago de Cuba. Lorsque j’arrive à Santa Clara au quartier général des Forces armées révolutionnaires, tout le monde est sur le pied de guerre et on m’informe qu’une invasion a eu lieu : « Les Américains ont débarqué ! ». Tel était le bruit qui courait à l’époque dans toute l’île. Par la suite, nous avons appris qu’il s’agissait de renégats cubains à la solde des États-Unis et non de troupes conventionnelles. Je demande où a eu lieu le débarquement et l’on me répond « Playa Girón ». Je n’avais absolument aucune idée de l’endroit. Je n’y avais jamais mis les pieds.
Je me suis incorporé au peloton et nous nous sommes rendus à Girón. Nous sommes entrés par Yaguaramas. Dès les premiers instants de l’invasion, Fidel a été en première ligne des combats. Cela nous a donné une force morale. Il est apparu fusil à l’épaule comme tous les combattants et ne s’est pas contenté d’un discours Place de la Révolution à La Havane. Il était accompagné d’autres commandants. Tous les habitants de la zone se sont soulevés contre les envahisseurs, alors que les États-Unis pensaient que le peuple allait se retourner contre le gouvernement révolutionnaire. Plusieurs bataillons qui luttaient contre les bandits dans l’Escambray se sont joints à la lutte. En moins de 72h, les mercenaires ont été écrasés par le peuple en armes.
SL : Vous avez participé à la guérilla du Che Guevara au Congo. Comment est né ce projet ?
VD : J’ai eu l’opportunité historique de participer à la guérilla aux côtés du Che en Afrique, au Congo Kinshasa. Le Mouvement de Libération de Joseph Désiré Kabila avait sollicité notre aide, suite à l’assassinat de Patrice Lumumba par les États-Unis et la Belgique. Il avait besoin de former son personnel et d’envoyer une trentaine d’officiers chez nous afin de recevoir une préparation militaire. Fidel a donné son accord mais a suggéré que les Cubains aillent directement sur place pour former les militants dans les conditions réelles, tout en participant aux combats contre le régime de Mobutu. C’était la meilleure chose à faire pour nous et pour eux.
Quand nous sommes arrivés au Congo, nous nous sommes rendus compte que Fidel avait raison. Les caractéristiques géographiques du pays étaient différentes de celles de Cuba. Nous nous sommes rendus compte de cela durant l’étape de préparation. Par exemple, à Cuba, on pouvait monter sur un arbre pour regarder au loin et surveiller les éventuels mouvements des troupes ennemies. Au Congo, cela était impossible en raison de la densité de la végétation. Il était impossible d’avoir une vision au loin. Nous avons découverts ces spécificités sur place.
SL : Comment s’est déroulé le processus de sélection ?
VD : Nous étions 130 conseillers au total. Tous étaient volontaires. J’ai été chargé par Fidel, Raúl, le Commandant Piñeros et Osmany Cienfuegos de préparer le groupe avant le départ. Mon nom de guerre était Roberto pour les Cubains. Personne ne savait que le Che allait se joindre au groupe, pas même moi. Je me souviens qu’Osmany Cienfuegos est venu me voir avec plusieurs photos du Che rasé et maquillé par nos spécialistes. Il ne ressemblait en rien au Che que je connaissais. Osmany m’a dit la chose suivante : « Voici le commandant Ramón que tu connais ». Je lui ai répondu que je ne l’avais jamais vu de ma vie. Tous les commandants se connaissaient entre eux. J’étais moi-même commandant. Nous nous rencontrions régulièrement pour diverses tâches.
Un jour, alors que je me trouvais au campement, on est venu me chercher et nous sommes allés dans une maison où se trouvaient divers compagnons d’armes. J’étais assis à table et je vois Osmany s’approcher avec le monsieur de la photo. Je me lève, comme me l’a enseigné mon père. Il me disait toujours : « Il faut toujours se lever pour saluer les gens s’ils sont animés de bonnes intentions et pour pouvoir se défendre s’ils s’approchent avec des intentions hostiles ». Je salue donc le commandant Ramon qui avait un cigare à la bouche. Osmany insiste : « Je te dis que tu le connais ». Je me creusais la tête pour essayer de me souvenir qui était cet individu, sans succès. Puis, « Ramon » a pris la parole et a dit « Osmany, arrête d’embêter Dreke ». Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai reconnu le Che.
SL : Comment se sont déroulées les opérations au Congo ? Le Che a parlé d’échec.
VD : La grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés était le manque d’unité parmi les forces révolutionnaires du pays. Il y avait beaucoup de divisions entre les différentes factions. Nous avons décidé de former une première compagnie sous la direction de Tamayo qui partait durant plusieurs semaines pour réaliser des actions de combat. On a ensuite formé une deuxième colonne sous mes ordres. Mais il y avait de trop nombreuses difficultés. Quand nous sommes arrivés, l’ennemi avait déjà infiltré les troupes et se répandait déjà l’idée de chercher une entente pacifique et d’abandonner la voie des armes.
Je ne partage pas l’avis du Che. Pour moi, l’opération au Congo n’a pas été un échec. Nous devions nous adapter aux réalités du pays et suivre les ordres des chefs congolais. Le Che n’était pas le chef de la guérilla. Il devait suivre les directives des responsables locaux. Le Che était le chef du groupe d’internationalistes cubains. Nous n’avions pas de pouvoir de décision. Nous pensions que les leaders congolais devaient agir comme l’avaient fait Fidel et Raul, c’est-à-dire être le fusil à l’épaule, au combat avec les troupes. Dans notre doctrine militaire, dans notre philosophie de combat, le chef est toujours avec ses troupes, en première ligne, affronte le danger et montre l’exemple. Mais ce n’était pas le cas au Congo. Kabila avait une autre vision des choses. Fidel avait insisté sur le fait que nous devions suivre les directives des Congolais et de ne jamais imposer notre point de vue. Nous exprimions notre opinion et nous laissions les dirigeants du pays prendre les décisions.
Loin d’être un échec, l’opération au Congo a permis aux autres peuples en lutte de comprendre la manière dont il fallait mener la guerre contre le colonialisme et quelles erreurs ne pas commettre, que ce soit en Angola ou en Guinée Bissau. Notre attitude a été exemplaire et six de nos camarades sont tombés au combat au Congo. Ce fut un exemple qui a servi pour l’histoire, notamment pour l’histoire de l’Afrique. Le Che fait partie de l’histoire de l’Afrique.
L’entreprise au Congo n’a pas été un échec. Nous avons pu convaincre nos frères africains que nous pouvions conquérir la liberté par la voie des armes.
SL : Que représente la figure du Che pour vous et pour le peuple cubain ?
VD : Le Che était une âme noble. On parle souvent du guérillero, mais c’était d’abord et avant tout une âme noble. Il était d’une grande générosité. On ne renonce pas ce qu’on a de plus cher – sa famille, sa patrie, ses amis, son bien-être – si l’on n’est pas fait de grandeur. C’était un homme juste, énergique, ferme, un exemple, qui n’a jamais maltraité personne, encore moins les prisonniers.
Le peuple cubain voue une vénération au Che, encore plus que de son vivant. Y compris les jeunes, qui ne l’ont jamais connu, ont un grand respect pour sa figure. Il faut se découvrir dès lors que l’on mentionne son nom, en mémoire à son histoire et à son sacrifice pour la cause des humbles.
SL : Après le Congo, vous avez pris la tête de la mission militaire qui s’est rendue en Guinée Bissau et au Cap Vert où Amilcar Cabral menait la lutte armée contre le colonialisme portugais. Racontez-nous cette histoire.
VD : Après le Congo, nous avons apporté notre concours à la lutte de libération nationale du peuple de Guinée Bissau. Sékou Touré, le premier Président de Guinée, a joué un rôle important dans la décolonisation de l’Afrique. Il nous a apporté un grand soutien durant nos missions sur le continent. Nous avons d’ailleurs formé les milices à Conakry pour prévenir un coup d’État contre Touré de la part des Portugais. Touré, courageux et solidaire, était un soutien d’Amilcar Cabral.
En Guinée Bissau, la situation était différente de celle du Congo. Après la Conférence tricontinentale à La Havane de 1966, Amilcar Cabral a sollicité notre aide et souhaitait un soutien technique. Il ne voulait pas que les Cubains participent aux combats.
Amilcar Cabral était l’un des leaders révolutionnaires les plus lucides de son époque et l’avait démontré lors de la Conférence tricontinentale où il s’était exprimé en faveur de la lutte armée. Il disposait d’une formation intellectuelle solide. Jorge Risquet, notre homme en Afrique, l’avait rencontré au Congo Brazzaville et avait été impressionné par sa vision. Risquet lui avait proposé des hommes, mais Amilcar avait refusé en soulignant qu’il avait seulement besoin de formateurs et de conseillers car il revenait aux Guinéens eux-mêmes de libérer leur propre pays. « Nous devons faire notre Révolution nous-mêmes », avait-il dit. Il souhaitait préparer l’avenir du pays en formant son peuple pour assumer les responsabilités de l’indépendance. Amilcar avait réussi la prouesse d’unir son peuple sous le drapeau de l’indépendance, ce qui n’était pas chose aisée, à la fois en Guinée Bissau et au Cap Vert, deux territoires distincts et non limitrophes, distants de près de 1 000 kilomètres. Il était cap-verdien par son père et guinéen par sa mère. Malheureusement, Amilcar Cabral a été assassiné par des traîtres à la solde de Lisbonne, quelques mois avant l’indépendance de sa patrie.
SL : Qu’est-ce qui motive un internationaliste à réaliser une mission loin de sa terre natale, avec tous les sacrifices que cela suppose ?
VD : C’est d’abord et avant tout un appel du cœur. Quand on voit la misère, l’oppression, la pauvreté qui frappent les plus vulnérables, on ne peut pas rester insensible à cela. On sent au plus profond de nous une exigence morale d’agir pour porter secours à ces peuples en lutte pour leur dignité. C’est la raison pour laquelle, en plus des missions militaires, j’ai dirigé une école internationaliste à Cuba. Par la suite, j’ai mené des projets de construction en Afrique, en Guinée Bissau, au Cap Vert, au Mozambique et en Angola.
Il faut souligner que nous sommes toujours intervenus à la demande des peuples. Nous n’avons jamais imposé notre présence à personne. Nous sommes allés au Congo à la demande des révolutionnaires de Kabila et nous avons quitté le pays lorsqu’ils ont considérés que notre mission était arrivée à son terme. Il est important de rappeler cette réalité. Le Che n’a pas quitté le Congo de son propre chef. Il n’a pas abandonné le Mouvement de Libération Nationale. Nous sommes partis parce que Kabila nous a demandé de quitter le pays.
SL : Avez-vous visité l’Algérie durant cette époque-là ?
VD : Je me suis rendu à Alger en 1967 et j’ai même rencontré le Président Houari Boumediene. C’était notre première visite depuis 1965 et le départ du pouvoir de Ben Bella. Je me souviens que Boumediene m’avait demandé de transmettre un message de solidarité à Fidel. Nous avons toujours eu de grands rapports avec l’Algérie, notamment avec Ben Bella. Nous avons un grand respect pour les Algériens. L’unité entre Cuba et l’Algérie a été très forte. On ne peut pas oublier les liens, notamment durant les premières années de la Révolution cubaine et les premières années de l’indépendance de l’Algérie. Les années 1960 étaient révolutionnaires et glorieuses.
SL : Qu’avez-vous fait à votre retour à Cuba et quelle est votre fonction aujourd’hui ?
VD : J’ai intégré les Forces armées au sein de différentes unités. J’ai été chef de construction. J’ai fondé l’Armée juvénile du travail dans la région orientale qui était chargée de la production agricole, notamment pour des cultures telles que la canne à sucre et le café. J’ai également été Chef de la Direction politique centrale des Forces armées.
Aujourd’hui, je suis Président de l’Association d’amitié Cuba-Afrique. Pour nous, Cubains, l’Afrique est le symbole de résistance d’un peuple, d’un continent, qui a été maltraité, brimé et qui a résisté. Aujourd’hui, les peuples d’Afrique disent « non » aux puissants, ce qui n’était pas évident à l’époque, à l’exception de quelques dirigeants tels que Sékou Touré ou Ahmed Ben Bella. Notre peuple descend des Africains réduits en esclavage arrachés à leur terre natale pour être exploités en Amérique. Notre culture est africaine. Combien d’Africains sont morts à Cuba ? On ne peut pas séparer Cuba de l’Afrique. Pour nous, Cubains, l’Afrique, c’est notre cœur, notre sang.
SL : Dernière question : que représente la figure de Fidel Castro pour les Cubains ?
VD : J’ai eu deux pères dans ma vie : Dreke Castillo et Fidel Castro. Voilà ce que signifie Fidel pour moi. Il m’a appris à avoir une ligne de conduite, de l’honneur, des principes. Il m’a appris qu’il fallait toujours se relever après être tombé. C’est la raison pour laquelle nous résistons au blocus économique criminel que nous imposent les États-Unis depuis des décennies. Fidel nous a appris à résister durant les moments difficiles, à ne jamais courber l’échine quelles que soient les circonstances. Pour cela, nous pouvons compter sur le soutien des peuples d’Afrique et d’ailleurs.






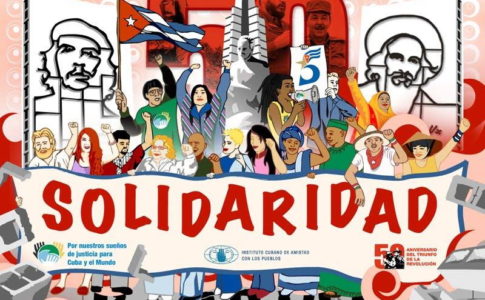


Aucun commentaire